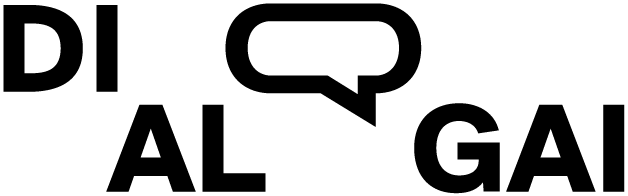Dans 38 pays d’Afrique subsaharienne, l’homosexualité est encore une infraction pénale et, dans quatre d’entre eux, elle est même passible de la peine de mort. C’est le cas notamment en Mauritanie ou encore au Soudan. Au-delà des législations, les agressions et les persécutions visant les homosexuels sont de plus en plus fréquentes et visibles sur le continent. C’est ce qui ressort du tout dernier rapport d’Amnesty International intitulé Quand aimer devient un crime. La criminalisation des relations entre personnes de même sexe en Afrique subsaharienne, publié le mardi 25 juin.
Dans 38 pays d’Afrique subsaharienne, l’homosexualité est encore une infraction pénale et, dans quatre d’entre eux, elle est même passible de la peine de mort. C’est le cas notamment en Mauritanie ou encore au Soudan. Au-delà des législations, les agressions et les persécutions visant les homosexuels sont de plus en plus fréquentes et visibles sur le continent. C’est ce qui ressort du tout dernier rapport d’Amnesty International intitulé Quand aimer devient un crime. La criminalisation des relations entre personnes de même sexe en Afrique subsaharienne, publié le mardi 25 juin.
Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty International France, répond aux questions de RFI.
RFI : L’homophobie est-elle de plus en plus présente dans le discours public, qu’il soit politique ou religieux ?
Geneviève Garrigos : Ces dernières années, nous avons vu un accroissement des discours homophobes et de la violence vis-à-vis des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI). De plus, compte tenu des contextes légaux, l’homosexualité est criminalisée et donc pénalisée dans 38 Etats africains. Cela veut dire que les personnes agressées ne peuvent pas porter plainte parce qu’elles risqueraient elles-mêmes de se faire arrêter et ensuite incarcérer.
Sur quels ressorts se fonde ce discours homophobe que l’on entend de plus en plus en Afrique ?
Il y a d’abord toute une partie du discours qui se fonde sur les religions, que ce soit l’islam ou les religions chrétiennes. Il y a ensuite tous ceux qui disent que l’homosexualité ou la transsexualité ne sont pas africaines mais qu’elles ont été importées par le colonisateur. Or, c’est exactement l’inverse qui s’est passé.
Lorsque nous regardons la situation dans de nombreux pays africains, nous nous apercevons que les pratiques en termes d’homosexualité, d’orientation sexuelle ou d’identité de genres existaient avant et c’est le colonisateur lui-même qui a importé ces lois de criminalisation de l’homosexualité. Malgré la décolonisation, ces lois homophobes sont restées dans les codes des pays concernés. Et aujourd’hui, c’est ce vestige du colonialisme qu’on voudrait faire passer pour une réelle africanité.
Du point de vue de l’évolution des lois, il y a toujours en Ouganda cette épée de Damoclès d’une proposition de loi qui prévoirait la peine de mort pour l’homosexualité. Où en est-on ?
Depuis 2009, en Ouganda il y a effectivement des projets de loi qui sont proposés pour imposer une loi anti-homosexuelle qui permettrait de condamner à mort ceux qui pratiquent les relations sexuelles entre personnes du même sexe.
La loi en question va encore plus loin, car elle permet de criminaliser aussi tous ceux qui seraient au courant ou qui pourraient connaître des personnes homosexuelles et qui ne les dénonceraient pas dans les 24 heures. Si tel était le cas, ces personnes commettraient une violation de la loi et pourraient donc être arrêtées et jugées. On retrouve cette même législation dans d’autres pays comme par exemple au Nigeria et au Liberia, lorsqu’il y a des durcissements de la loi.
Il y a des pays où être homosexuel n’est pas un crime. C’est le cas, par exemple, en Afrique du Sud mais vous avez recensé, malgré tout, des violences et des meurtres motivés par l’orientation sexuelle des victimes…
L’Afrique du Sud fait partie des pays qui ont une des lois des plus avancées. C’est d’ailleurs le seul pays de l’Afrique subsaharienne qui, depuis 2006, autorise le mariage entre personnes du même sexe et l’adoption.
Malgré ces avancées législatives, il existe toujours un fond d’homophobie très fort avec des attaques, y compris physiques. Depuis juillet 2012, nous avons eu cas d’au moins 7 jeunes femmes qui auraient été violées puis tuées en raison de leur homosexualité. Et ce qui nous inquiète beaucoup, c’est que les enquêtes n’ont pas avancé et les présumés coupables n’ont toujours pas été identifiés. Et cela est dû à l’inertie de la police et du système judiciaire, toujours au regard de cette homophobie latente dans la population.
Il y a aussi le cas du Cameroun où l’on arrête les homosexuels sur dénonciation et où on a eu vent de mauvais traitements sur des homosexuels en détention, de chantage et de racket de la part des policiers ?
Le Cameroun est tout à fait symptomatique de ces situations où on n’a même pas besoin d’avoir des preuves que la personne soit effectivement homosexuelle. Il suffit que ce soit une dénonciation anonyme, sans aucune preuve, pour que les personnes soient arrêtées et condamnées.
Bien entendu, un tel climat de suspicion et de dénonciations permet toutes les agressions, toutes les violations y compris le chantage, le racket et autres contre les personnes LGBTI.
Cependant, ce que nous observons aujourd’hui, au niveau du Cameroun, c’est que de plus en plus la communauté LGBTI se dresse pour dénoncer les violations qu’elle subit.
Quel état des lieux faites-vous, y compris dans les pays où l’homosexualité n’est pas considérée comme un crime ?
Dans les pays où l’homosexualité n’est pas considérée comme un crime, il peut y avoir des discriminations par rapport au travail, à l’accès au logement ou encore à l’accès aux soins. Certains pays adoptent justement des législations pour arrêter la discrimination. C’est ce que nous avons vu récemment à l’Ile Maurice, au Cap Vert, à São Tomé et Príncipe, ou encore dernièrement au Kenya.
Même si l’homosexualité est toujours criminalisée au Kenya, la nouvelle loi contre les discriminations précise bien que ces dernières ne peuvent avoir lieu dans aucun cas et ce terme général inclut également l’identité de genre et l’orientation sexuelle.
Il y a donc des avancées mais elles restent encore aujourd’hui trop marginales et, de fait, nous nous apercevons que même s’il n’y a pas de loi qui pénalise ou qui criminalise les personnes LGBTI, il va falloir encore du temps et des volontés politiques fortes pour éradiquer cette homophobie latente au sein des populations qui ont trop souvent été utilisées – et qui le sont encore trop souvent – par les hommes, notamment politiques, et certains religieux pour stigmatiser une partie de la population.
© Nathalie Amar (RFI)